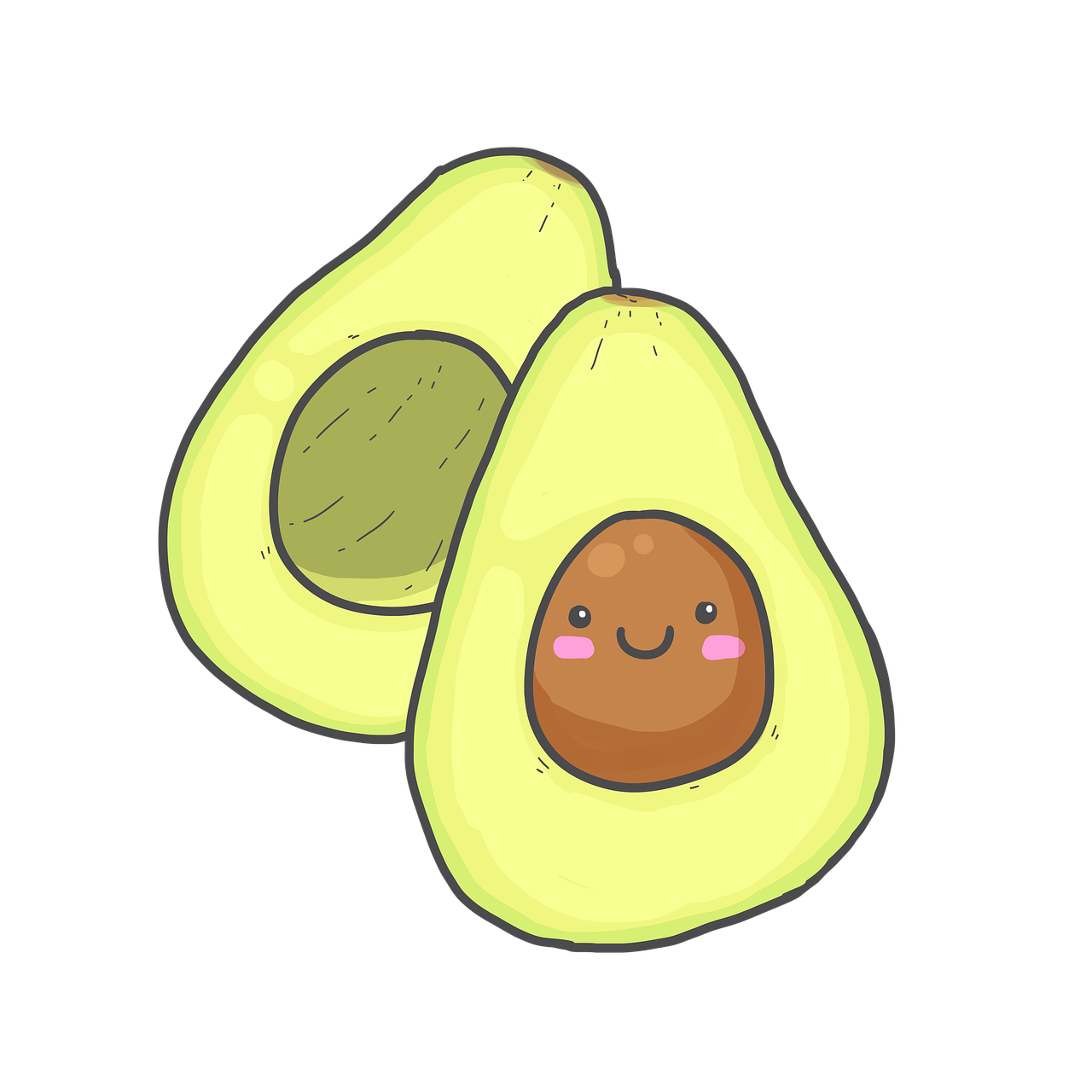|
EN BREF
|
Un musée français émet en moyenne 9000 tonnes de CO2 par an, équivalant à l’empreinte écologique de 800 Français. Cette réalité met en lumière les enjeux cruciaux auxquels les musées doivent faire face dans le cadre de la transition écologique. La prise de conscience récente, notamment après la crise sanitaire et des crises énergétiques, a conduit à un regain d’intérêt pour les questions environnementales au sein des institutions culturelles. Les musées sont désormais encouragés à adopter des pratiques plus durables pour réduire leur empreinte carbone et s’engager dans des démarches visant à limiter leur impact sur l’environnement.
La question de l’empreinte carbone des musées français prend une ampleur cruciale dans le cadre de la transition écologique. En moyenne, un grand musée en France génère environ 9000 tonnes de CO2 chaque année, ce qui correspond à l’empreinte annuelle de près de 800 citoyens. Ce chiffre soulève des enjeux environnementaux majeurs auxquels doivent répondre ces institutions culturelles. Après des crises successives telles que la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques entraînant une montée des crises énergétiques, une prise de conscience est nécessaire. Ce phénomène, couplé à l’émergence de nouveaux rapports et directives, pousse les musées à repenser leur modèle de fonctionnement en faveur d’une durabilité accrue.
Contexte et enjeux de la transition écologique
La transition écologique des musées s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le changement climatique. Le secteur culturel, qui a longtemps été considéré comme à l’écart des enjeux environnementaux, est désormais confronté à des questions pressantes concernant son impact. En effet, des études révèlent qu’un grand musée français peut générer jusqu’à 9000 tonnes de CO2 par an. Cette situation appelle à une refonte profonde des pratiques et des politiques au sein de ces institutions, qui sont souvent perçues comme des lieux de conservation et de célébration de la culture plutôt que comme des contributeurs à la dégradation environnementale.
Un musée, une empreinte carbone considérable
Les résultats d’études menées par divers organismes confirment que l’empreinte carbone des musées est colossale. Par exemple, le rapport du Shift Project met en lumière la vulnérabilité des institutions face aux crises écologiques à venir. Avec une émission moyenne de 9000 tonnes de CO2 par an par musée, l’impact cumulé de ces établissements sur la planète est alarmant. Pourquoi un tel chiffre ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la consommation énergétique, les déplacements pour les expositions et la production d’une multitude de matières premières pour la scénographie.
Les crises qui réveillent les consciences
La prise de conscience de l’importance de la durabilité dans le secteur culturel a été accélérée par des événements comme la pandémie de Covid-19 et la crise énergétique provoquée par des tensions internationales. Ces crises ont mis en exergue les failles des systèmes en place et ont incité le monde de la culture à repenser ses pratiques. La publication de rapports, comme celui de l’UNESCO, témoigne du besoin impérieux de redynamiser le secteur avec un nouveau modèle de durabilité. Aude Porcedda, sociologue et muséologue, souligne que le Covid a fait exploser les questions environnementales, suscitant un besoin de changement dans le domaine culturel.
Des acteurs clés de la transition
Les musées de société
Les musées de société, tels que le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, se sont positionnés comme des leaders dans la transition écologique. Ouvert en 2006, cet établissement a rapidement compris l’importance de sa responsabilité environnementale face à la destruction des écosystèmes. En 2014, il a amorcé des actions concrètes pour réduire son empreinte écologique, comme la collaboration avec des agences pour la gestion de la « fin de vie » des expositions, afin de limiter le gaspillage des ressources. Ce type de démarche est essentiel pour montrer l’exemple dans un monde qui a besoin de solutions. Le PBA de Lille a aussi emprunté cette voie, mettant en place un diagnostic déchets et choisissant de ne réaliser de « grosses » expositions qu’une année sur deux pour rationaliser sa consommation de ressources.
Les musées d’art
Historiquement, les musées d’art ne se sont pas toujours sentis concernés par ces enjeux. Cependant, la prise de conscience s’est accentuée au cours des dernières années. Des musées tels que le palais des Beaux-Arts de Lille ont pris des mesures significatives pour diminuer leur empreinte carbone. Par exemple, cette institution a su s’appuyer sur ses collections permanentes pour limiter le recours à des pièces nécessitant un transport long et coûteux en énergie. La volonté de repenser les expositions sur un modèle plus durable devient indispensable. Emmanuel Marcovitch, ancien directeur de la Réunion des Musées nationaux, a lui-même reconnu la nécessité de changer de modèle d’exposition, citant des actions visant à éco-concevoir les activités muséales.
La politique nationale et les directives des ministères
Sur le plan national, le ministère de la Culture s’engage à soutenir cette transition grâce à des lignes directrices claires et à des financements spécifiques. Le Guide d’orientation et d’inspiration publié en 2023, souligne l’importance d’intégrer les indicateurs d’impact écologique dans les projets muséaux. L’objectif est d’accompagner à la fois les grands musées et ceux de plus petite taille dans leur transformation. En parallèle, l’État a déblayé des fonds pour soutenir des projets liés à la rénovation énergétique, permettant ainsi aux institutions de transformer leurs infrastructures et de procéder à des modernisations pérennes.
À l’étranger : des expériences inspirantes
Au niveau international, certains musées européens se démarquent par leur engagement en faveur de pratiques durables. Le musée d’Ethnographie de Genève a été le premier en Europe à obtenir le label Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale (THQSE). Outre-Atlantique, le Baltimore Museum of Arts a également initié des projets visant à réduire son empreinte carbone tout en sensibilisant le public aux problèmes environnementaux. Ces initiatives font écho au besoin de réponse collective face à des défis globaux, incitant les musées à repenser leurs pratiques en intégrant des réflexions sur leur impact environnemental.
Les mesures de sobriété et les pratiques durables
Afin de lutter contre leur empreinte carbone, les musées mettent en œuvre divers outils de sobriété énergétique. Cela inclut le raccordement à des réseaux de chauffage urbains, la limitation des températures d’éclairage et l’utilisation de solutions d’éclairage écologique. La collaboration entre les institutions permet également de profiter d’une approche mutualisée pour leurs achats et de s’orienter vers des produits écoresponsables. Par exemple, des établissements comme Universcience incitent leur public à emprunter des moyens de transport à faible empreinte carbone, encourageant ainsi une culture du changement et de responsabilité dans la société.
La lutte contre l’empreinte carbone des musées est un combat culturel, social et environnemental. Ils ont maintenant la responsabilité d’évoluer dans un sens durable tout en préservant leur mission d’intérêt général. C’est en se montrant exemplaires, comme le font certains d’entre eux, qu’ils pourront non seulement diminuer leur impact, mais également impacter positivement leurs visiteurs et le grand public. En intégrant la transition écologique dans leurs pratiques, les musées français peuvent devenir des modèles de durabilité et montrer la voie vers un futur plus respectueux de notre planète.

Transition écologique des musées : un impératif urgent
Une réalité alarmante émerge dans le monde de la culture : un musée français génère en moyenne 9000 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à l’empreinte annuelle de huit cents Français. Ce constat met en lumière l’urgence d’une transition écologique au sein des institutions culturelles, une nécessité à laquelle de nombreux acteurs commencent à répondre.
Selon plusieurs professionnels du secteur, la prise de conscience collective s’est intensifiée à la suite de la pandémie de Covid-19. Aude Porcedda, muséologue, affirme : « La crise sanitaire a fait exploser les questions environnementales au sein du monde de la culture. » Cette révélation a poussé de nombreux musées à revoir leurs pratiques et à questionner leur impact environnemental.
Des initiatives comme celle du musée du Quai Branly, qui a intégré des démarches de réduction de son empreinte écologique depuis 2014, témoignent d’une volonté de changement. Un responsable de cette institution souligne : « Nous avons une responsabilité particulière en matière environnementale ; il est impératif d’œuvrer pour la pérennité des cultures en danger. »
Les résultats d’études révèlent que des établissements tels que le palais des Beaux-Arts de Lille ont modifié leur approche pour ne faire de grandes expositions qu’une fois tous les deux ans. Cette décision vise à limiter les émissions dues aux transports et à encourager l’utilisation de leurs collections permanentes. Bruno Girveau, ancien directeur de l’établissement, explique : « Nous devons adopter une démarche écoresponsable en optimisant les ressources que nous avons déjà. »
D’autres musées, comme le Mucem à Marseille, ont également changé leur modèle d’exposition. Yamina El Djoudi, responsable de la production culturelle, affirme : « En 2024, nous avons réussi à réduire notre consommation énergétique de 20% par rapport à 2013. Chaque geste compte pour la planète. »
Les écomusées, nés dans les années 1960 et 1970, sont également des pionniers dans ce domaine. Céline Chanas, présidente de la Fédération des écomusées, précise : « La dimension de réemploi est obligatoire dans nos institutions, car nous sommes souvent contraints par une économie de moyens. » Cette philosophie de sobriété et de responsabilité devrait servir de modèle à d’autres institutions.
Même à l’échelle internationale, les institutions tentent de réduire leur impact environnemental. Le musée d’Ethnographie de Genève se distingue par sa démarche performante de développement durable. Alice Audouin, consultante en arts, mentionne le projet du Baltimore Museum of Arts qui s’est lancé dans un ambitieux programme environnemental, reflet d’un engagement croissant à travers le monde.
Il est indéniable que la transition écologique est un enjeu crucial pour les musées : changer les pratiques et adopter des modèles durables est désormais indispensable pour préserver l’art et la culture à long terme, tout en luttant efficacement contre le changement climatique.